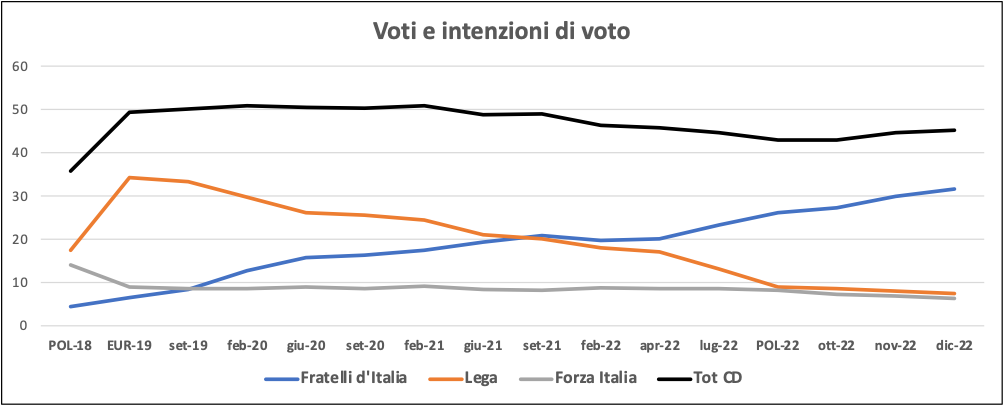Follemente corretto (7) – Nero di seppia
Supponete di aver invitato a cena per venerdì Angela, una vostra amica afroamericana di passaggio per l’Italia. Qualche giorno prima, diciamo martedì, cenate – sempre a casa vostra – con un’altra amica, Anna, bianca ed europea come voi. Anziché farle il solito risotto al parmigiano, vi lanciate in uno spettacolare risotto al nero di seppia.
La cosa viene alle orecchie di Angela, l’amica nera d’oltre oceano, che dagli Stati Uniti vi fa sapere che no, lei a casa vostra non intende più mettere piede. Ha saputo della vostra cena con Anna e del risotto al nero di seppia, “una pratica razzista e arcaica, che non ha diritto di cittadinanza nella società moderna”. Lei da voi a cena non verrà più, per rappresaglia.
Se vi capitasse, che cosa fareste?
Personalmente penserei che la mia amica Angela ha perso la testa, o ha un esaurimento, o sta scherzando.
Invece no. La Fondazione Arena di Verona, che organizza gli spettacoli nel meraviglioso anfiteatro di quella città si è trovata in una situazione simile, ma ha preso molto sul serio la faccenda.
I fatti. Nel mese di luglio il soprano Anna Netrebko interpreta il ruolo di Aida, principessa etiope, nella celebre opera di Verdi. Come di consueto, dovendo mettere in scena un personaggio nero, ed essendo Anna Netrebko bianca, si ricorre al blackface, la pratica di scurire il volto. Un artifizio scenico quali ve ne sono innumerevoli nel teatro, come la gobba di Rigoletto messa indosso a baritoni con la schiena normale.
Pochi giorni dopo, dovrebbe andare in scena la Traviata, con il soprano Angel Blue, afroamericana nel ruolo di Violetta. Ma lei, come la vostra amica invitata a cena per venerdì, disdice sdegnosamente l’invito, perché qualche giorno prima l’Arena di Verona, in altra opera (Aida) e con altra interprete (Anna Netrebko) è ricorsa al blackface, come peraltro si è sempre fatto in casi simili.
La ragione? Secondo Angel blue la pratica del blackface è razzista:
“L’uso del blackface in qualsiasi circostanza, artistica o meno, è una pratica basata su tradizioni teatrali arcaiche che non hanno posto nella società moderna”.
La cosa curiosa, in tutta questa storia, è la reazione della Fondazione Arena di Verona. Anziché rivendicare l’autonomia artistica della regia (peraltro firmata da Zeffirelli), e il pieno diritto delle istituzioni di operare entro una tradizione culturale, arcaica o meno che essa risulti agli occhi di qualcuno, i responsabili della Fondazione hanno ritenuto di doversi giustificare, con argomenti invero penosi: non avevamo intenzione di offendere (come se una persona sana di mente potesse offendersi), l’allestimento è di 20 anni fa (e allora?), se vieni a Verona “potremo dialogare in modo costruttivo partendo proprio dalle tue riflessioni”.
Ma giustificarsi equivale ad ammettere che aver fatto il risotto con il nero di seppia a Anna possa essere offensivo per Angela. Mentre la vicenda dimostra solo due cose molto semplici.
Primo, che il politicamente corretto riesce a “scalare impensabili vette di stupidità”, come giustamente ha osservato Cesare Cavalleri su “Avvenire”.
Secondo, che l’accusa di razzismo, per quanto pretestuosa, campata per aria, priva di sostanza o stupida sia, ha uno straordinario potere intimidatorio. Chiunque la subisca, si sente tenuto a fornire giustificazioni, se non a confessare la sua colpa, come accadeva nei processi staliniani.
Brutta faccenda. Non poter ridere del ridicolo è un segnale inquietante, e inequivocabile, di una civiltà che sta smarrendo sé stessa.